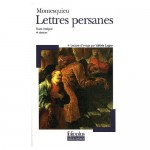C’est en 1781 qu’un pasteur suisse, le Dr Schwartz publie, à Neuchâtel, le court livre Réflexions sur l’Esclavage des Nègres. Une dénonciation de l’esclavage, qui démonte les arguments des esclavagistes sur les plans humaniste, juridique, économique et culturel.
Il est étonnant que ce bon Monsieur Joachim Schwartz, pasteur du Saint-Évangile à Bienne et membre de la Société économique de B*** d’après le livre, ne fasse pas partie, au regard de la portée forte de ce texte, de la galerie des antiesclavagistes à laquelle les oreilles du grand-public ont pu être éduquées.
Les connaisseurs de la langue de Goethe auront peut-être souri en lisant le nom dudit pasteur. Le Dr Schwartz ? Le Docteur Noir, voulez-vous dire ? Ah, je comprends mieux !
Derrière l’ironie de ce pseudonyme, c’est en effet Nicolas de Condorcet qui a tenu la plume de ces Réflexions, texte majeur sur la route vers l’abolition de l’esclavage.

Un peu plus d’un siècle plus tôt, Le Code noir, ou Édit du Roy servant de règlement pour le gouvernement et l’administration de justice et la police des isles françoises de l’Amérique, et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans ledit pays, formalisait les règles infâmantes de la traite des esclaves et privait les esclaves de toute personnalité civile et juridique, faisant d’eux de simples biens mobiliers (peu glorieuse année, cet an 1685, qui voit à la fois l’édiction du Code noir et la révocation de l’édit de Nantes...). Les plus cyniques voyaient dans ce Code un moyen de protéger les esclaves de l’arbitraire absolu qui prévalait jusque-là ; de quoi rendre acceptable l’inacceptable. Un Code qui aura la vie longue, puisqu’il durera jusqu’en 1785, après divers remaniements qui en renforceront la portée...

Au Siècle des Lumières s’affrontent partisans et adversaires de l’esclavage, et même les philosophes « éclairés » avaient, sur ce sujet, des positions contrastées. Parmi les antiesclavagistes, certains s’attaquent à l’esclavage par l’ironie, comme Montesquieu, en 1748, dans De l’esprit des loix (sic), ou Voltaire, dans un des épisodes de Candide ou l’Optimisme (1759) ; d’autres abordent le sujet sous l’angle du droit de nature, de l’esprit de la religion, ou encore de l’économie, comme le chevalier de Jaucourt dans les articles « Esclavage » et « Traite des Nègres » de l’Encyclopédie, ou de la vie en société, comme Jean-Jacques Rousseau, dans Du Contrat social (1762) ; d’autres encore mettent en scène des personnages dont l’un défend l’esclavage et l’autre en réfute les arguments ; ainsi l’abbé Raynal dans L’histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes (1770).
Et en 1781, c’est donc le Dr Schwartz, alias Marie-Jean-Antoine Nicolas Caritat, marquis de Condorcet, homme de sciences et de philosophie qui publie ses Réflexions sur l’esclavage des Nègres (première édition à Neuchâtel ; édition revue et corrigée à Paris, 1788). Le ton est donné dès l’épître dédicatoire aux esclaves : « Mes amis, quoique je ne sois pas de la même couleur que vous, je vous ai toujours regardés comme mes frères. »

La publication de la première et, surtout, de la deuxième édition a provoqué des élans dans les deux camps, pro- et anti-esclavage. Aux élans de la Société des Amis des Noirs, abolitionniste, répond l’intense lobbying du Club de l’hôtel de Massiac, du nom de la résidence parisienne de l’autoproclamé marquis de Massiac où se réunit une société rassemblant plusieurs dizaines, puis plusieurs centaines de colons des Antilles farouches partisans du maintien de l’esclavage.
Pour mémoire, après une première abolition par la Convention nationale en 1794, l’esclavage est rétabli en 1802, avant d’être définitivement aboli en avril 1848.
Cet ouvrage de Condorcet, texte pionnier et – fait rare jusque-là, entièrement consacré au sujet de l’esclave – est de ceux qui nous amène à regarder le monde différemment, à bousculer nos certitudes, nos préjugés, à sortir de la facilité, à éveiller notre conscience de nous-mêmes et des autres. Il y a encore tant de progrès à faire que bousculer les consciences est un effort salutaire de tous les jours.
* * * * *
Un peu de lecture
Un exemple d’édition des Réflexions sur l’esclavage des Nègres, de Condorcet (éditions Flammarion, collection GF Philosophie, 2009, ISBN 978-2081220010).
En complément, les lecteurs curieux pourront se tourner vers les Réflexions sur la traite et l’esclavage des Nègres, d’Ottobah Cugoano (Thoughts and Sentiments on the Evil and Wicked Traffic of the Slavery and Commerce of the Human Species, Humbly Submitted to the Inhabitants of Great-Britain, by Ottobah Cugoano, a Native of Africa , 1787 ; 1788 pour la traduction française), et vers The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African (1789), deux des premiers ouvrages militant pour l’abolitionnisme écrits par des anciens esclaves.
Des éditions sont disponibles en français ; par exemple :
Ottobah Cugoano, Réflexions sur la traite et l’esclavage des nègres (éditions Zones, 2009, ISBN 2-355-22017-4).
Olaudah Equiano, Ma véridique histoire (éditions Mercure de France, coll. Le temps retrouvé, 2008, ISBN 978-2715228580).
* * * * *